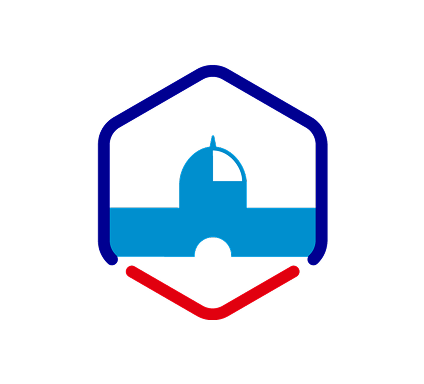2019-10-15
Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, la question du traitement des corps des soldats morts sur les champs de bataille évolue progressivement, même si de très nombreux militaires sont encore inhumés en tombe collective. Avec la Grande Guerre, l’individualisation des sépultures des soldats devient une question essentielle pour les familles et les autorités. Plusieurs lois, en particulier celle du 29 décembre 1915, consacrent le rôle de l’État qui est, dès lors, en charge de l’entretien des sépultures des militaires décédés au cours d’opérations de guerre avec attribution officielle de la mention « Mort pour la France ». Ce devoir à caractère perpétuel ne concerne toutefois que les corps qui n’ont pas été restitués aux familles qui en avaient fait la demande.
Aujourd’hui, 291 nécropoles nationales et plus de 2 200 carrés militaires répartis sur l’ensemble du territoire national conservent les restes mortels de près de 800 000 Morts pour la France. 88 % d’entre eux sont décédés lors de la Première Guerre mondiale. Certains reposent en ossuaire, faute d’avoir pu être identifiés au moment de l’inhumation.
Dans les conditions prévues par le Code des Pensions militaires, le ministère des Armées (DMCA)) est responsable des sites regroupant les sépultures de guerre qui relèvent de l’État.
Opérateur du ministère des Armées dans le champ mémoriel, l’ONaCVG met pour sa part en œuvre la politique d’entretien, de rénovation et de valorisation de l’ensemble de ces sites hautement symboliques. Lieux de recueillement et de commémorations, les nécropoles nationales et les carrés militaires sont aussi des lieux de transmission mémorielle à destination des jeunes générations.

Les visiteurs ont découvert les panneaux de l’exposition « La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires partagées? » et ont été sensibles à la pédagogie des propos, à la richesse de l’iconographie et au respect de toutes les mémoires.
Par ailleurs, de nombreux objets de cette période provenant de différentes collections, aussi bien civils que militaires, ont été présentés tels que des uniformes, des insignes, des objets du quotidien (trousse de toilette, quart, cahier de cours…), et des photos.
Enfin, un espace était aménagé dans la salle pour regarder des courtes vidéos, mêlant analyse d’historiens et témoignages des acteurs du conflit algérien. Ces supports audiovisuels ont permis aux spectateurs d’entendre les points de vue des divers protagonistes de cette guerre.
La préparation d’une telle manifestation a nécessité l’aide de nombreux partenaires :
– La mairie d’Angers, les Archives départementales, le musée du Génie d’Angers pour la salle, les vitrines et le matériel

– Les associations combattantes et patriotiques qui ont mobilisé leurs adhérents pour l’installation, l’accueil et la surveillance de la salle : l’Association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie – Tunisie – Maroc (ACPG-CATM) de Maine-et-Loire, le Comité départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), l’Association départementale de l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Maine-et-Loire, l’association départementale des Harkis du Maine-et-Loire, veuves et orphelins (Harkis 49), l’amicale des porte-drapeaux d’Angers et de la région angevine, l’amicale des prisonniers de guerre, évadés et réfractaires de Maine-et-Loire, l’association départementale des parachutistes de l’Anjou, souvenir des parachutages et des combats du Bois d’Anjou 1944, le groupement de Maine-et-Loire de l’association nationale des officiers de carrière en retraite, des veuves, veufs et orphelins d’officiers (ANOCR), la société d’entraide de la médaille militaire pour le Maine-et-Loire, la section de Maine-et-Loire des mutilés et invalides de guerre, l’Union nationale des organisations et des officiers de réserve de l’Anjou.
– Enfin, les collectionneurs qui ont fourni les uniformes, les photos et plusieurs vidéos personnelles.
Cette rétrospective a été un succès puisque près de 650 personnes sont venues la voir parmi lesquelles de nombreuses familles souhaitant en savoir davantage sur un conflit méconnu.
Sylvère VESNIER, ONACVG de Maine-et-Loire
© ONACVG