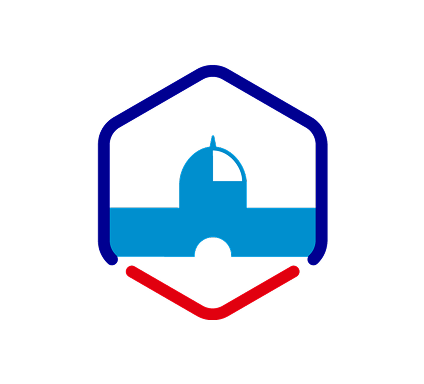2021-04-20
Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, la question du traitement des corps des soldats morts sur les champs de bataille évolue progressivement, même si de très nombreux militaires sont encore inhumés en tombe collective. Avec la Grande Guerre, l’individualisation des sépultures des soldats devient une question essentielle pour les familles et les autorités. Plusieurs lois, en particulier celle du 29 décembre 1915, consacrent le rôle de l’État qui est, dès lors, en charge de l’entretien des sépultures des militaires décédés au cours d’opérations de guerre avec attribution officielle de la mention « Mort pour la France ». Ce devoir à caractère perpétuel ne concerne toutefois que les corps qui n’ont pas été restitués aux familles qui en avaient fait la demande.
Aujourd’hui, 291 nécropoles nationales et plus de 2 200 carrés militaires répartis sur l’ensemble du territoire national conservent les restes mortels de près de 800 000 Morts pour la France. 88 % d’entre eux sont décédés lors de la Première Guerre mondiale. Certains reposent en ossuaire, faute d’avoir pu être identifiés au moment de l’inhumation.
Dans les conditions prévues par le Code des Pensions militaires, le ministère des Armées (DMCA)) est responsable des sites regroupant les sépultures de guerre qui relèvent de l’État.
Opérateur du ministère des Armées dans le champ mémoriel, l’ONaCVG met pour sa part en œuvre la politique d’entretien, de rénovation et de valorisation de l’ensemble de ces sites hautement symboliques. Lieux de recueillement et de commémorations, les nécropoles nationales et les carrés militaires sont aussi des lieux de transmission mémorielle à destination des jeunes générations.

Six totems en libre accès se succèdent sur le trottoir, côté Hôtel de ville, du boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation à Angers.
Ils évoquent l’histoire d’Angevins qui luttèrent dans la Résistance pour libérer leur pays durant la Seconde Guerre mondiale, ou qui furent victimes des persécutions antisémites des nazis et de leurs complices entre 1940 et 1944. Beaucoup d’entre eux ne sont jamais revenus des camps de concentration.
Créée par la mairie d’Angers dans le cadre de la Journée nationale du souvenir de la déportation (25 avril) et de la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie (8 mai), cette exposition compte six thématiques parmi lesquelles les résistants de la première heure, les femmes dans la Résistance, les déportés raciaux.

Pour concevoir cette exposition, la ville d’Angers s’est attachée le concours de plusieurs personnalités et institutions : l’historien Alain Jacobzone, les Archives départementales de Maine-et-Loire, l’ONACVG de Maine-et-Loire, le Comité départemental de la Résistance, de la Déportation et de la Victoire, la délégation départementale de la Fondation de la France libre et l’association départementale des Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation. Le musée de l’Ordre de la Libération et Yad Vashem, institut international pour la mémoire de la Shoah, ont également été associés.
Les visiteurs sont invités à découvrir les visages et les parcours de celles et ceux qui, confrontés à la barbarie, illustrent à quel point la liberté, le respect d’autrui et la solidarité sont des biens précieux pour l’Humanité.
Sylvère Vesnier, ONACVG de Maine-et-Loire
© ONACVG