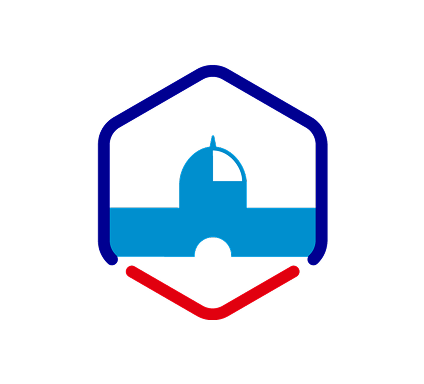2022-09-28
Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, la question du traitement des corps des soldats morts sur les champs de bataille évolue progressivement, même si de très nombreux militaires sont encore inhumés en tombe collective. Avec la Grande Guerre, l’individualisation des sépultures des soldats devient une question essentielle pour les familles et les autorités. Plusieurs lois, en particulier celle du 29 décembre 1915, consacrent le rôle de l’État qui est, dès lors, en charge de l’entretien des sépultures des militaires décédés au cours d’opérations de guerre avec attribution officielle de la mention « Mort pour la France ». Ce devoir à caractère perpétuel ne concerne toutefois que les corps qui n’ont pas été restitués aux familles qui en avaient fait la demande.
Aujourd’hui, 291 nécropoles nationales et plus de 2 200 carrés militaires répartis sur l’ensemble du territoire national conservent les restes mortels de près de 800 000 Morts pour la France. 88 % d’entre eux sont décédés lors de la Première Guerre mondiale. Certains reposent en ossuaire, faute d’avoir pu être identifiés au moment de l’inhumation.
Dans les conditions prévues par le Code des Pensions militaires, le ministère des Armées (DMCA)) est responsable des sites regroupant les sépultures de guerre qui relèvent de l’État.
Opérateur du ministère des Armées dans le champ mémoriel, l’ONaCVG met pour sa part en œuvre la politique d’entretien, de rénovation et de valorisation de l’ensemble de ces sites hautement symboliques. Lieux de recueillement et de commémorations, les nécropoles nationales et les carrés militaires sont aussi des lieux de transmission mémorielle à destination des jeunes générations.

Devant le monument aux morts de l’école de cavalerie de Saumur, se sont rassemblés les autorités civiles et militaires pour la cérémonie d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.
À cette occasion, M. Tayeb Kacem, président de l’association Harkis 49, a rappelé les sacrifices consentis par les supplétifs qui ont fait le choix de la France. Il a également salué les avancées en matière de reconnaissance et de réparation grâce à la loi du 23 février 2022. Celle-ci prévoit l’indemnisation des personnes ayant été accueillies de façon indigne dans des camps de transit et des hameaux de forestage à la suite de leur rapatriement d’Algérie, après les accords d’Évian de 1962.
À l’issue de la cérémonie, les autorités et le public ont été conviés à assister au vernissage de l’exposition de l’ONACVG « Parcours de harkis et de leurs familles » présentée au musée de l’école de cavalerie, place Charles-de-Foucauld, à Saumur.

La première adjointe du maire de Saumur et le général commandant les écoles militaires de Saumur ont souligné la qualité des textes et des photos choisies pour illustrer les 20 panneaux composant l’exposition.
En parallèle, les visiteurs ont pu découvrir une série d’objets et de vêtements en lien avec l’histoire des harkis sélectionnée par les équipes du musée de la cavalerie.
Cette rétrospective, qui a attiré plus de 2000 personnes lors des journées du patrimoine, sera visible jusqu’au 1er novembre 2022.
Sylvère Vesnier, ONACVG de Maine-et-Loire
© ONACVG